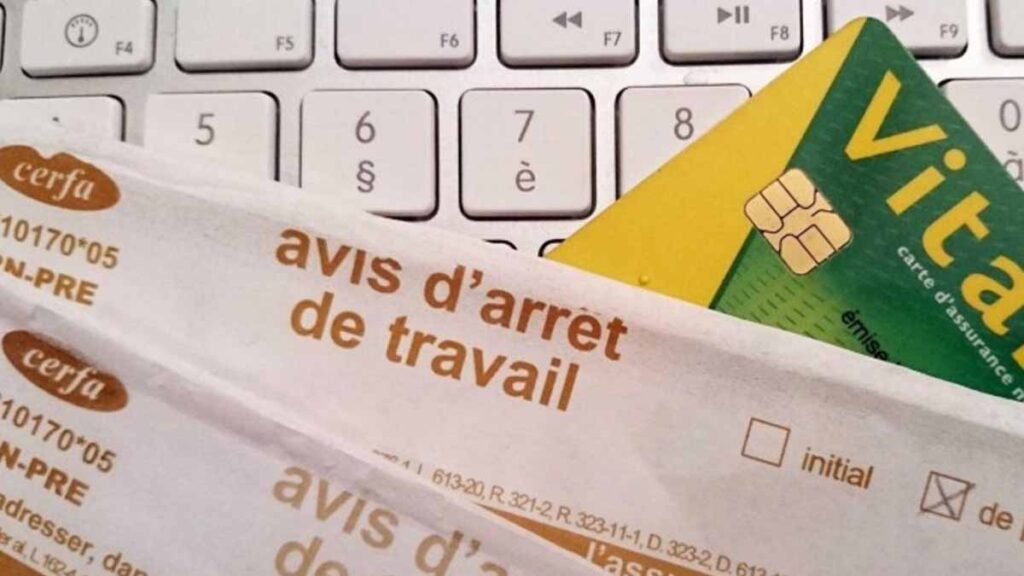Le Rassemblement national secoue le débat public en proposant d’allonger à trois jours la durée d’arrêt maladie des fonctionnaires.
Le débat sur l’arrêt de travail n’a rien d’abstrait. Il touche directement la vie des millions de Français qui, un jour ou l’autre, doivent poser leur stylo, quitter leur poste, et se soigner. Derrière une mesure technique se cachent des questions bien plus larges : comment équilibrer le budget de l’État ? Quelle place donner à la protection sociale ? Et surtout, quelle équité entre salariés du privé et agents du public ? Ces enjeux brûlants ont récemment refait surface, lors de l’intervention de Jean-Philippe Tanguy, député de la RN, invité de l’émission Face à BFM. Ses propos ont relancé une vieille polémique : faut-il allonger la durée de carence des fonctionnaires avant indemnisation ?
Trois jours pour tout changer
Actuellement, le système est simple sur le papier, mais inégal dans la pratique. Dans la fonction publique, un agent en arrêt de travail n’est pas payé pendant une journée. Passé ce délai, il retrouve son traitement, avec des règles précises qui varient selon la durée de l’arrêt. Dans le privé, les choses sont différentes : trois jours de carence, mais avec la possibilité d’un maintien de salaire partiel, parfois même intégral, selon la convention collective ou l’assurance complémentaire de l’entreprise. Une disparité que certains jugent insupportable.
Jean-Philippe Tanguy ne s’en cache pas : il souhaite mettre fin à ce qu’il considère comme un traitement privilégié des fonctionnaires. Son idée est d’instaurer trois jours de carence obligatoires, alignés sur le privé. Derrière ce discours, l’argument budgétaire est omniprésent. Le coût des indemnités journalières explose depuis plusieurs années. Le gouvernement, la Cnam et le patronat observent avec inquiétude cette progression, perçue comme une fuite continue dans les comptes publics. Allonger la carence, selon eux, pourrait ralentir l’hémorragie.
Mais cette proposition a déjà un passé mouvementé. En début d’année, François Bayrou avait écarté une mesure similaire, sous pression des socialistes. L’opinion publique, elle, reste partagée. D’un côté, beaucoup de salariés du privé estiment que l’égalité devant la règle est une évidence. De l’autre, les syndicats rappellent que les fonctionnaires subissent déjà un jour de perte sèche, sans compensation, alors que certains salariés du privé bénéficient d’accords avantageux. Le débat reste vif, car derrière la technique se joue une question de justice sociale.
Rigueur budgétaire et justice sociale : l’avenir de l’arrêt de travail
Réduire les dépenses est une obsession récurrente pour tous les gouvernements, peu importe leur couleur politique. L’arrêt de travail cristallise parfaitement ce dilemme. Celui de préserver la santé des travailleurs tout en freinant une courbe budgétaire jugée insoutenable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Dans le privé, l’indemnisation a de quoi surprendre. Elle s’élève à 50 % du salaire de base journalier. Ce, avec un plafond fixé pour 2025 à 41,47 euros par jour. Dans le public, les trois premiers mois sont indemnisés à 90 % du traitement indiciaire, avant de tomber à la moitié du salaire pendant neuf mois supplémentaires. Des règles complexes, qui entretiennent l’impression d’un système à deux vitesses.
Le risque, en rallongeant la carence, serait d’accentuer la défiance. Beaucoup redoutent que la mesure ne pénalise les plus fragiles : petits salaires, familles seules, employés soumis à des métiers physiques. Une journée sans revenu peut déjà déstabiliser un foyer, alors trois jours… Certains y voient une incitation à venir travailler malgré la maladie, au détriment de la santé et du collectif. À l’inverse, les partisans de la réforme martèlent qu’il s’agit d’une question de responsabilité et d’équilibre. Personne n’imagine un système social durable si les dépenses échappent à tout contrôle.
La vérité se situe peut-être entre les deux. La France a construit son modèle social sur une idée forte : protéger chacun dans les moments de faiblesse. Mais cette promesse coûte cher, et chaque réforme rappelle que les équilibres sont fragiles. La proposition de la RN ne passera peut-être pas telle quelle. Elle marque pourtant une tendance : celle d’un débat récurrent, où l’arrêt maladie devient le terrain d’affrontement entre rigueur budgétaire et justice sociale. Et à mesure que les échéances électorales approchent, ce sujet reviendra immanquablement sur la table. Car derrière une mesure technique, c’est bien la vision de la solidarité nationale qui se joue.