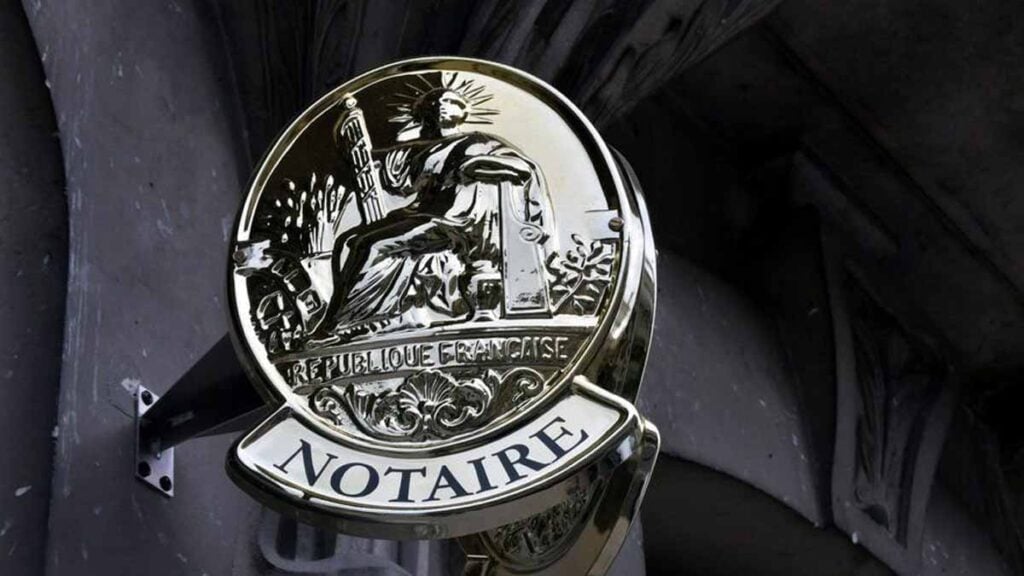Deux ventes en viager intriguent : des notaires ont-ils profité de deux octogénaires, ou simple stratégie patrimoniale assumée ?
À quoi pense-t-on quand on entend « viager » ? Souvent à un coup de poker immobilier, parfois à une solution paisible pour les vieux jours. Mais quand ce sont les notaires en viager qui achètent eux-mêmes les biens, la confiance vacille. Et quand deux femmes âgées décèdent peu après avoir signé, la justice, elle, se réveille.
Un procès s’est ouvert. Trois notaires sur le banc des accusés. Une histoire où s’entrelacent stratégie patrimoniale, soupçons d’abus, et un malaise tenace.
Le viager, un pari… mais pour qui ?
Le premier dossier remonte à 2018. Une femme de 83 ans vend sa maison en viager. Estimée à 250 000 euros, elle part pour 56 000 euros seulement. À cela s’ajoutent 700 euros par mois, et la charge des travaux laissée à la propriétaire elle-même. L’acheteur ? Un notaire. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais moins de cinq ans plus tard, la vieille dame meurt. Résultat : le bien, fraîchement rénové, revient au couple acquéreur pour à peine 87 000 euros.
L’année suivante, rebelote. Une autre octogénaire cède un bien estimé à 140 000 euros. Montant de la vente : 30 000 euros. Elle décède… vingt-huit jours après la signature. L’acheteur ? Encore un notaire. Deux ventes, deux décès, deux bonnes affaires – mais un arrière-goût désagréable. Les notaires en viager à Toulouse se retrouvent au centre d’une affaire qui dépasse le simple cadre juridique. On touche ici à la morale, à la responsabilité, à la vulnérabilité humaine.
Le tribunal s’interroge. Les prix, l’urgence des décès, le lien entre professionnels et clientes… Rien n’est illégal en soi. Mais quand les pièces s’assemblent, le doute s’installe. Trop de coïncidences, trop d’écarts entre la valeur estimée et le prix final. Et surtout, un déséquilibre criant entre les parties.
Entre devoir moral et soupçon d’abus
Face à ces faits, le parquet a sorti la loupe. Trois enquêtes ont été ouvertes. L’une interne à la profession. Une autre civile, déjà tranchée avec une condamnation du couple. Et la dernière, pénale, confiée à la division de la criminalité organisée.
Dans la salle du tribunal, l’atmosphère était électrique. Trois professionnels du droit, respectés jusqu’alors, ont dû répondre de leurs actes. Ce lundi, les réquisitions sont tombées : peines de prison avec sursis pour les trois accusés, 30 000 euros d’amende pour le couple. La décision finale tombe le 1ᵉʳ juillet.
Le débat se joue à la frontière du droit et de l’éthique. D’un côté, la défense souligne que tout a été fait dans les règles : consultations juridiques, certificats médicaux récents, aucune pression apparente. Le viager reste un contrat aléatoire, rappellent-t-ils. La mort peut survenir n’importe quand. Rien ne prouve qu’ils aient anticipé ou provoqué quoi que ce soit.
Mais d’un autre côté, l’image du notaire en tant qu’acheteur fragilise la position. Un notaire, c’est censé être un garant, pas un investisseur. La frontière entre conseil et intérêt personnel devient floue. Et ce flou, dans une profession fondée sur la confiance, devient insupportable.
Le marché du viager, déjà regardé avec prudence, observe cette affaire de très près. Car elle soulève une vraie question : jusqu’où peut aller un professionnel du droit sans trahir l’esprit de sa fonction ? Quand la personne en face est âgée, isolée, peut-être affaiblie, le doute ne devrait jamais profiter au plus fort.
Une affaire qui secoue la profession
Ce procès dépasse les murs du tribunal. Il touche à quelque chose de plus large : la place des notaires en viager dans la société. Leur rôle n’est pas seulement de sceller des actes, mais de protéger les plus fragiles. Quand cette mission est remise en cause, c’est toute la chaîne de confiance qui vacille.
Les professionnels du viager, eux aussi, regardent avec attention. Le viager n’est pas un terrain neutre. C’est un contrat sensible, souvent chargé d’émotion, de solitude, d’espoir aussi. Il exige une éthique irréprochable. Pas juste des textes respectés à la lettre.
Aujourd’hui, la profession prend un coup. Mais elle a aussi l’occasion de se repositionner. D’affirmer, haut et fort, que l’argent ne doit jamais primer sur la dignité. Que le droit peut être humain, s’il garde les yeux ouverts.